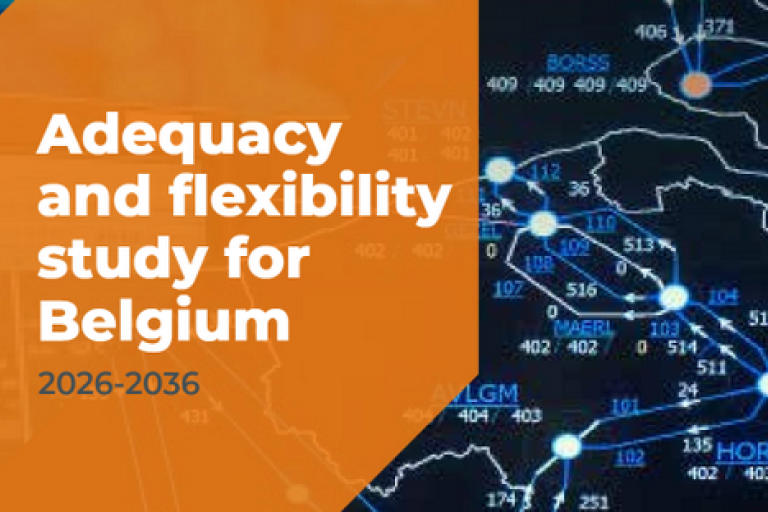Dans le cadre de la transition énergétique, les gestionnaires de réseau de transport et de distribution d’électricité (GRT/GRD) promeuvent actuellement activement la flexibilité technique des raccordements. Cela signifie concrètement que la capacité nominale de raccordement au réseau n’est pas garantie à 100% et que l’usager de réseau peut être modulé – sans qu’aucun mécanisme de compensation ne soit prévu - voire être à certains moments dans l’incapacité totale d’injecter ou de consommer à partir du réseau, ce à l’initiative du gestionnaire de réseau. De cette manière, une solution temporaire peut être proposée afin de permettre - dans l'attente des investissements nécessaires dans le réseau - le raccordement de capacités supplémentaires tout en garantissant la sécurité du réseau. Cette flexibilité technique repose sur des mécanismes contractuels comme les raccordements avec accès flexible en prélèvement.
Mais cette flexibilité ‘imposée’ - contrairement à la flexibilité implicite et explicites ‘volontaires’ - peut engendrer des tensions lorsqu’elle freine la rentabilité des investissements et entre en conflit avec les contraintes opérationnelles spécifiques de certains usagers du réseau.
Pour illustrer ces tensions, un exemple pertinent est celui de l’électrification du transport routier lourd (HDV). Dans ce secteur, la viabilité économique repose sur le coût total de possession (TCO) des camions électriques, qui intègre non seulement le prix du matériel roulant et de l’électricité, mais aussi des paramètres logistiques cruciaux : temps de charge pendant les pauses des chauffeurs, coût du personnel actif/inactif, et vitesse moyenne de transit des marchandises.
Il est important ici de distinguer les recharges au dépôt, qui sont par nature plus flexibles (grâce à la flexibilité implicite ou explicite), des recharges « en transit », notamment le long des axes structurants du réseau TEN-T. Ces dernières doivent impérativement s’effectuer dans des fenêtres temporelles précises, souvent courtes, et ne peuvent tolérer de pilotage ou de réduction de puissance sans compromettre l’efficacité logistique. C’est là que la flexibilité technique imposée par le réseau peut devenir une contrainte rédhibitoire.
Ce cas illustre un conflit entre deux intérêts légitimes : celui du gestionnaire de réseau, garant de l’équilibre et de la sécurité du système, et celui de l’usager, soumis à des impératifs économiques et opérationnels propres à son secteur. Il ne s’agit pas d’une opposition de principe, mais d’un besoin de reconnaissance mutuelle des contraintes.
D’ailleurs, le secteur logistique par exemple ne souhaite pas être perçu comme un frein à la transition, mais bien comme partie prenante de la solution. La majorité des recharges se feront au dépôt, dans des conditions plus flexibles. Mais pour les cas critiques, un dialogue est nécessaire.
Plus fondamentalement, il importe de rappeler que le réseau électrique doit rester un levier au service de la transition énergétique et de l’électrification de l’économie, et non en devenir un frein. Les investissements dans les infrastructures, la planification proactive et les mécanismes de raccordement doivent viser à accompagner le développement des usages électrifiés et décarbonés, tout en garantissant la sécurité du système. Le réseau, en tant qu’infrastructure, doit être conçu comme un catalyseur de solutions électrique et bas-carbone, soutenant l’innovation et la compétitivité des acteurs qui s’engagent dans la transition.
Face à cette complexité, la FEBEG appelle à instaurer un dialogue structuré entre les gestionnaires de réseau et les usagers. Il s’agit de coconstruire des solutions équilibrées, fondées sur la transparence des contraintes techniques et économiques, et sur la reconnaissance mutuelle des impératifs sectoriels. La flexibilité ne doit pas devenir une contrainte imposée, mais un levier partagé au service de la transition énergétique. La FEBEG plaide en outre pour la mise en place d’un marché de la flexibilité.